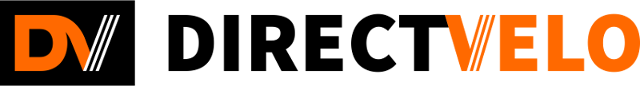Jean-Jacques Loup : « Vive le cyclisme africain ! »

"L'Afrique est un idéal". Vingt courses africaines au compteur, le directeur sportif suisse Jean-Jacques Loup vient de boucler le Tour du Rwanda ce dimanche, à la tête de l'équipe Meubles Descartes. L'ex-dirigeant de Post Swiss Team et de Phonak (première version) raconte à DirectVelo.com comment l'Afrique peut régénérer le sport.
DirectVelo.com : A quel moment est apparue votre passion pour l'Afrique ?
Jean-Jacques Loup : Aux Paris-Dakar des premiers temps. J'ai disputé la cinquième édition, en 1983. Tout de suite, j'ai été happé par les odeurs, les feux qui brûlent la nuit dans le désert, les lampes à pétrole qui nous éclairent, les couleurs, les paysages, les gens qui nous regardent avec de grands yeux ... L'Afrique est un idéal, celui d'une certaine pureté. J'aimais l'idée d'une culture préservée, d'un respect pour la nature et pour certaines espèces que nous, en Europe, nous ne pouvions pas voir. A l'époque, je voyageais beaucoup comme pilote moto : en Europe de l'Est, aux Etats-Unis, en Grèce... Il me fallait de l'aventure. Pour un gamin né en 1945, la Suisse des années 60 n'était pas très marrante. Ainsi, je suis allé chez le coiffeur pour la première fois quand j'avais 15 ans. Dans ce contexte, voyager sur d'autres continents vingt ans plus tard, en particulier en Afrique, était une chance que je savourais intensément.
L'Afrique, synonyme d'aventure ?
Oui, j'ai besoin de ça. Je suis parti sur mon premier Paris-Dakar à la dernière minute, très excité – aujourd’hui, je fais encore ma valise à cinq minutes du départ. Le Dakar, c'était une aventure folle à travers l'Afrique. Nous étions parfois seuls dans le désert, la nuit à porter notre moto. La trouille au ventre. Les conditions de bivouac étaient très dures. Certains l'ont dit avant moi : ce que nous avons fait, des chiens ne l'auraient pas accepté. Mais il s'agissait toujours d'une difficulté consentie.
« L'AFRIQUE EST ACCUEILLANTE »
Le Dakar, est-ce néo-colonial ?
Je ne vois pas les choses ainsi. J'étais dans ma bulle de coureur. Par ailleurs, l'histoire coloniale en Afrique concerne un certain nombre de nations, mais pas la Suisse. Je n'avais pas cette idée en tête. Les critiques contre le Paris-Dakar me semblaient infondées : l'Europe ne venait pas jouer en Afrique, mais l'Afrique nous prêtait son stade. J'ai vu des spectateurs fiers que nous venions, heureux de nous croiser, curieux de ce que nous faisons.
La relation avec les populations locales ?
L'Afrique m'a toujours semblé accueillante. Ceci remonte à mon enfance, quand nous allions à l'école du dimanche, pour un enseignement chrétien. Il y avait notre « petit nègre » – à l'époque, le terme n'était pas péjoratif. Il s'agissait d'une statue d'Africain, dans laquelle nous pouvions glisser un peu d'argent, pour une œuvre de charité. Chaque fois que l'on introduisait une pièce, la statue inclinait la tête en signe de remerciement. Tout petit, je pensais que les Africains étaient gentils, à cette image.
L'Afrique et ses mythes...
Bien sûr, c'est un idéal. Je me rappelle avoir entraîné ma famille dans un lieu de vacances dans un coin idyllique que j'avais traversé en moto. Mais nous n'avons trouvé sur place qu'une tente pleine de poussière et une piscine remplie de gravats. Un lieu très quelconque... Mon souvenir l'avait embelli parce que le jour de mon passage, j'étais épuisé et quelqu'un m'avait tendu un verre de lait...
« EN AFRIQUE, ON SE PARLE, ON DEVIENT AMI »
En même temps que vos participations au rallye moto, vous découvrez les courses cyclistes en Afrique ?
J'ai couru le Paris-Dakar en 1983, 84, 85 et 89. Ma première épreuve de vélo africaine remonte au Tour du Faso 1987, où je travaillais comme moto dépannage et info, pour le compte de Mavic. La marque a aussi parrainé mes équipes cyclistes Elite (amateur) en Suisse.
Le romantisme du Dakar, c'est terminé ?
[L'air ennuyé.] La seule odeur que l'on respire aujourd'hui, c'est celle des gaz d'échappement. Les engins presque bricolés ont disparu. Si un concurrent rencontre un ennui technique, il est assisté par une quinzaine de personnes en un éclair. Les populations locales n'ont plus le droit d'accéder aux bivouacs. Certes, la course est techniquement très évoluée. Les intérêts financiers ont grimpé aussi. D'ailleurs, on a gardé le nom du Paris-Dakar sur un parcours organisé en Amérique du Sud. C'est la preuve à la fois que cette épreuve que nous avons courue reste un mythe et que l'épreuve actuelle a perdu de son caractère.
Ce romantisme, vous le retrouvez à travers le cyclisme africain ?
En Afrique, on se parle, on se côtoie, on devient ami. Les valeurs essentielles du sport subsistent.
« LE GIGANTISME A TOUT CASSE »
Selon vous, quand le cyclisme a-t-il perdu ces repères ?
Dans les années 2000. J'ai connu le tournant chez Phonak. Au début, le projet était familial, fondé sur la formation. A la fin, on me demandait de contacter Tyler Hamilton... C'est étonnant à imaginer, mais, au départ, en 2000, l'équipe était construite sur le modèle des précédents groupe que j'ai dirigés, le PMU-Romand (1996) et Post Swiss Team (1997-1999). Petit budget, effectif motivé, capable de battre parfois les grandes écuries. Andy Rihs [le fondateur et mécène de l'équipe, actuel propriétaire de la marque de cycles BMC] ne pensait pas au Tour de France. Quand on pense qu'il s'opposait au recrutement de Niki Aebersold. Il m'avait dit : « Pas de star dans l'équipe ! ». Par la suite, pour signer chez Phonak ou BMC, il fallait être au minimum Champion du Monde...
Que s'est-il passé ?
Le gigantisme a tout cassé. Je peux vous dire quel jour, à quelle heure ça s'est produit. Sur le Tour de Romandie 2000, notre Canadien Dominique Perras s'échappe dans le Col du Simplon, sur une étape qui sera remportée par Mario Cipollini. Le peloton le laisse partir, seul, pendant 1h30. Andy Rihs état devant sa télé et il m'a appelé le soir : « Ecoute, j'ai déjà rentabilisé mon année de sponsoring ! ». Il venait de comprendre le potentiel du vélo comme vecteur de communication. Toutes les équipes ont fait l'acquisition d'énormes bus pour servir d'objets publicitaires. On a fini par oublier les coureurs qui étaient dedans.
Les presque vingt cas positifs dans l'équipe ne vous ont pas étonné ?
Bien sûr que non. Dans le cyclisme du début des années 2000, le dirigeant d'équipe ne contrôlait plus rien. Il y avait d'un coté des sponsors, de plus en plus puissants, qui augmentaient leur investissement mais également leurs exigences. De l'autre des coureurs qui décidaient de tout. Et enfin, les médecins qui faisaient la pluie et le beau temps. Phonak suivait l'évolution du cyclisme, qui est aussi celle des autres sports. Comme Andy Rihs ne jurait que par le Tour de France, je suis parti après deux saisons de collaboration. Il voulait construire un nouveau système. Je ne savais pas faire.
« AVEC LE CŒUR ET LES CONNAISSANCES »
En Afrique, vous faites de la formation ?
Je suis revenu à mes fondamentaux. Chaque année, j'emmène un jeune. Au Tour du Rwanda, le défi s'appelle Justin Paroz, 19 ans [membre de l'Equipe nationale suisse Juniors en 2014, NDLR]. Il s'est bien comporté dans la montagne, malgré des problèmes gastriques en milieu de semaine. Les coureurs sont à l'écoute. Peut-être qu'ils se disent : « C'est la dernière fois qu'on voit le vieux ! » [rires]
Le niveau sportif semble franchement élevé ?
C'est vrai pour le cyclisme africain en général et rwandais en particulier (lire ici). Il faut tirer un coup de chapeau à Jock Boyer [l'ex-pro américain, qui a remonté l'équipe nationale du Rwanda à partir de 2007, NDLR]. On voit que dans ce pays, le sport n'est pas entravé par la corruption. Il progresse avec le cœur et les connaissances.
Vos coureurs vivent-ils l'aventure au quotidien, comme vous autrefois sur le Paris-Dakar ?
L'aventure est sans doute moins intense, plus encadrée, mais elle reste présente. Au Tour du Rwanda, ils ont été très dépaysés. Mais il y a des montagnes verdoyantes et, en cette saison, de la pluie. Certaines courses sont encore plus exotiques, comme le Tour du Faso, avec sa chaleur, sa poussière, sa traversée des savanes... Quoiqu'il en soit, nos coureurs viennent toujours en Afrique pour vivre une aventure. D'autres sont réticents à l'idée de faire le déplacement : ils sont soucieux de l'état des routes, de la sécurité, de la stabilité politique... Ceux qui surmontent ces peurs vivent une expérience inoubliable, où chaque détail les change de la routine de la Suisse. Le Tour du Rwanda a rempli les attentes de nos coureurs, ils les a mis à l'épreuve, sur le plan sportif est en-dehors. Le seul bémol, c'est les sifflets.
« VALORISER LES AFRICAINS »
Les sifflets ?
Nos coureurs ont été hués régulièrement sur le parcours. Je n'avais jamais vu ça. C'est une attitude qui existe dans le football, mais qui n'a rien à voir dans le cyclisme : on peut supporter son équipe nationale mais on doit respecter ses adversaires.
Sur le Tour du Rwanda, vos coureurs sont dominés par les Rwandais, les Erythréens et quelques autres, à l'exception de Lukas Winterberg, 6e du classement général. Qu'en déduisez-vous ?
Ils courent en novembre : un handicap pour un Européen. Ils ne sont pas tous grimpeurs : un problème au Rwanda. Deux d'entre eux venaient du Tour du Faso, terminé une semaine plus tôt, où ils avaient remporté une étape [Manuel Stocker] et terminé 2e d'une autre étape [Michael Kyburz]. La fatigue s'est faite sentir. Par ailleurs, certaines équipes africaines sont très fortes. Ce serait une grossière erreur de venir sur le continent en pensant qu'on a un avantage manifeste. Ici, le cyclisme existe parfois depuis trois générations, certaines nations travaillent, font de la détection ou de la formation de qualité. Nous, on est là pour faire notre course, peut-être aussi pour valoriser les Africains.
Comment ça ?
Ils sont très motivés à l'idée de se confronter à nous. En nous battant, ils se disent qu'ils ont un bon niveau... Et leur cyclisme progresse de plus belle.
Vous ne leur faites pas de cadeaux pour autant ?
Non, nous étions venus pour gagner une étape. Nous avons fait de notre mieux ici.
« LES AFRICAINS PEUVENT DOMINER LE CYCLISME MONDIAL »
Si l'Afrique est un mythe. Le cyclisme africain l'est-il également ?
Tout à fait. Si l'Afrique continue à se développer dans cette direction, elle finira par rendre au cyclisme ce que celui-ci a perdu en Europe. Sur le vieux-continent, notre sport est empêtré dans ses travers, parfois en panne de souffle. Ici, ce sport est jeune, très populaire, il cultive les bonnes valeurs. Peut-être qu'il faudra cinquante ans pour y parvenir, mais les Africains peuvent dominer le cyclisme mondial. C'est dans notre intérêt : pour les échanges, pour retrouver un nouvel élan. Et c'est dans le leur : certains coureurs africains pourront mener de très belles carrières en Europe, à l'image des footballeurs.
Hélas, l'exemple du ballon rond montre comment l'argent a fini par pourrir le sport en Afrique, comme ailleurs. Ici, c'est la fin d'un idéal ?
Sauf que le vélo reste un sport de passionnés. Il n'y a pas assez d'argent en jeu pour attirer les aigrefins...
Votre prochain projet en Afrique ?
Bon, j'arrive un peu au bout du parcours [sourire]... Mais j'aimerais beaucoup travailler avec le Faso, aider ses athlètes à s'intégrer dans des équipes helvétiques. Des discussions sont en cours. Par-dessus tout, je rêve de diriger une équipe africaine. Il y a quelques années, le club de la SNH, au Cameroun, m'avait approché à cet effet. Dommage que nous ne soyons pas allés au bout. Au lieu d'avoir un effectif avec quelques coureurs noirs au milieu des blancs, j'aurais mis les noirs au centre du projet, et les blancs afin de les aider. Comme j'ai revendu mon magasin de vélo il y a deux mois, j'ai davantage de temps de considérer un projet de ce genre. Je voudrais combiner le travail de formation et la culture africaine, je serais comblé. Si je peux me rendre utile...
Crédit photo : Pierre Carrey - www.directvelo.com